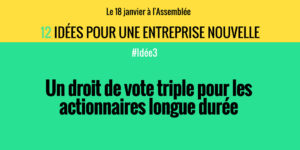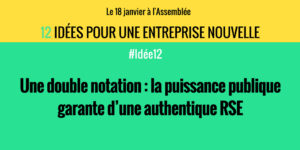Exposé des motifs / Présentation de la proposition de loi (dossier législatif)
La question de la justice et du progrès dans un monde fini, celle de la reconnaissance du travail comme une œuvre, la fragilité même de notre humanité appellent à une authentique révolution de la puissance publique afin de la mettre au service du bien commun et de la dignité humaine. Cette mutation ne sera pas possible sans la participation de toute la société civile. Pour y prendre sa part, le temps est venu pour l’entreprise de réussir une révolution civique, qui est aussi celle de l’efficacité dans son acception la plus large. Si dans les paroles et les actes, de nombreuses initiatives témoignent d’ores et déjà d’une transition porteuse d’avenir, les pratiques indécentes en matière actionnariale, managériale, financière et fiscale ont un effet dévastateur sur le pacte républicain et sur l’économie réelle qu’elle déstabilise par une concurrence inique. La loyauté - concept étonnamment moderne - apparaît ainsi comme le fil conducteur de ce texte. Elle est la condition sine qua non d’un authentique esprit d’entreprise que nous entendons promouvoir. Les obligations définies dans cette proposition de loi, comme les ouvertures qu’elle permet, donnent à l’entreprise sa pleine capacité à contribuer à une visée éthique partagée.
L’entreprise, en tant que forme sociale permettant l’organisation collective de la production et de l’innovation, doit être regardée comme un bien commun. Son efficacité participe de l’intérêt général. La juste détermination de ses droits, de ses devoirs, de ses pouvoirs et de sa gouvernance intéresse les salariés et, au-delà, l’ensemble des citoyens.
Enfin, si nous savons de longue date que les entreprises peuvent être le lieu de création d’externalités positives aussi bien que négatives, le phénomène est amplifié et accéléré par le mouvement de concentration et d’internationalisation, qui augmente leur puissance et les met en concurrence directe avec les États en matière de production de normes et d’allocation des ressources. La conception de l’entreprise, telle qu’elle existe dans le droit français, apparaît décalée par rapport à sa réalité contemporaine et archaïque au regard de sa mission au 21ème siècle. Elle n’est pas aujourd’hui suffisamment forte pour réguler efficacement les pratiques préjudiciables nées de la mondialisation. Elle prend insuffisamment en compte la question du travail, pourtant à l’origine de la valeur créée.
C’est la raison pour laquelle il convient de créer un cadre législatif plus adapté à la réalité d’aujourd’hui en posant les fondements d’une nouvelle entreprise. C’est une question structurante.
Les sources qui ont inspiré cette initiative parlementaire sont multiples, mais nous retrouvons pour l’essentiel le cercle réunissant le mouvement syndical, les ONG et les universitaires qui ont permis au printemps 2017 l’adoption de la loi sur « Le devoir de vigilance ». Lever le voile juridique entre les sociétés mères, leurs filiales et leurs sous-traitants est une innovation systémique qui fait aujourd’hui école dans le monde.
Les travaux du collège des Bernardins, autour de personnalités comme Antoine Lyon-Caen, Armand Hatchuel et Blanche Segrestin, ont été fondateurs de cette pensée nouvelle sur l’entreprise, également étudiée par la Fondation Jean Jaurès ; ils trouvent un vif écho dans les combats actuels contre le dumping social, environnemental et fiscal. Cette pensée nouvelle s’inspire également du mouvement de l’économie sociale et solidaire dans son aspiration à devenir le levier d’une transformation profonde de notre économie. Elle croise les pistes ouvertes par Cécile Renouard et Gaël Giraud sur le « facteur 12 » et l’idée d’une norme comptable européenne intégrant les externalités. Elle converge avec la réflexion juridique d’Alain Supiot, ou encore philosophique de Cynthia Fleury, signataire en 2016, avec 14 autres personnalités, d’un appel en faveur d’une économie de marché responsable.
Si l’idée d’une loi sur l’entreprise est née à l’université populaire d’esprit civique à Cluny le 6 octobre dernier, l’événement déclencheur revient à Olivier Favereau et Christophe Clerc qui ont réuni une centaine de personnalités autour d’une tribune publiée le même jour en faveur de la codétermination.
D’autres pas avaient été faits sous le quinquennat précédent, avec notamment la loi ESS, l’introduction d’administrateurs salariés dans les grandes entreprises privées ou le renforcement de l’actionnariat de long terme par la généralisation des droits de vote double dans les sociétés cotées. Il faut aller plus loin : les salariés le demandent, les investisseurs socialement responsables sont mobilisés et des chefs d’entreprise de plus en plus nombreux partagent ce combat.
La présente proposition de loi s’articule en conséquence autour de 9 articles comprenant des dispositions pour une majeure partie d’entre elles abouties et pour d’autres appelant à des approfondissements qui mobiliseront tant l’expertise du Gouvernement qu’un débat démocratique au sein de notre Assemblée et de la société civile. Elle s’articule autour de trois thèmes : la refondation de l’entreprise, son ancrage territorial et son enracinement dans la société.
Les quatre premiers articles visent à une transformation en profondeur de l’entreprise, en modifiant sa norme fondamentale de gestion et en donnant toute leur place aux salariés dans le gouvernement de l’entreprise et la répartition de la valeur ajoutée.
L’article 1er : « de l’entreprise au 21ème siècle »
La définition des sociétés, issue du code Napoléon, se concentre sur les associés et ne rend compte ni de la réalité de l’entreprise, ni de la recherche d’objectifs autres que le profit. Le nouvel article renverse cette perspective en prévoyant que « la société est gérée conformément à l’intérêt de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité ». Cet article connecte ainsi la société et l’entreprise et incite ses dirigeants à internaliser les externalités négatives qu’elle peut produire.
L’article 2 : « une codétermination à la française »
Depuis une trentaine d’années, le mouvement de la « suprématie actionnariale » a développé l’idée qu’il serait a priori naturel que le pouvoir de décision ultime revienne aux actionnaires. Cette idéologie se fonde sur deux idées dont nous devons démontrer la vacuité :
– L’actionnaire n’est pas propriétaire de l’entreprise mais de ses actions, qui sont des droits de créance auxquelles sont attachées des prérogatives limitativement énumérées par la loi.
– L’actionnaire n’est pas le seul à être exposé aux risques de l’entreprise, en tant que « créancier résiduel » ; la réalité économique montre l’importance du risque subi par les autres parties prenantes, au premier rang desquelles les salariés.
Ce mouvement idéologique a néanmoins obtenu d’importants succès législatifs en France et en Europe, qui ont contribué à la déformation du partage de la valeur ajoutée au profit des actionnaires. La capacité des salariés à influer sur le comportement et le gouvernement des entreprises est fragilisée sous l’effet non seulement des contraintes économiques, mais aussi des réformes législatives, qui tendent à réduire les protections individuelles et collectives des salariés. Nous considérons que les salariés doivent être considérés comme des parties constituantes de l’entreprise à venir, de façon à créer un cercle vertueux qui a fait ses preuves.
L’article propose donc de renforcer la présence des salariés dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance, dans le prolongement des lois de 2013 et 2015 qui ont prévu la présence d’un ou deux administrateurs salariés dans les grandes entreprises privées (c’est-à-dire celles ayant plus de 1 000 salariés en France ou 5 000 dans le monde). La proposition prend acte du fait que la présence d’administrateurs salariés existe dans la majorité des États membres de l’Union européenne et s’applique à compter de seuils allant de 35 salariés (au Danemark, avec un tiers d’administrateurs salariés dans les conseils) à 2 000 salariés (en Allemagne, avec une moitié de représentants salariés dans les conseils). Tout en instituant une clause de revoyure, il est proposé par une voie prudente d’avoir deux administrateurs salariés dans les entreprises de plus de 500 salariés, un tiers dans les entreprises de plus de 1 000 salariés et une moitié dans celles de plus de 5 000 salariés. Certaines lacunes seront par ailleurs comblées (par la fin des exemptions dont jouissent les sociétés par actions simplifiées) et le statut des administrateurs salariés sera renforcé ; en particulier, les entreprises auront désormais la faculté d’autoriser, par voie d’accord, le cumul des fonctions d’administrateurs salariés avec les mandats électifs ou syndicaux qu’ils détiennent, leur permettant ainsi d’exercer leurs fonctions dans une plus grande proximité avec les salariés.
Dans la même logique consistant à privilégier les parties constituantes qui ont un investissement et un intérêt pérenne dans l’entreprise, l’article propose d’introduire des droits de vote triple au profit des actionnaires détenant leurs actions depuis au moins cinq ans.
L’article 4 : « la participation dans les petites et moyennes entreprises » vise à reconnaître l’importance du travail collectif des salariés dans ces entreprises. Il propose d’étendre le bénéfice de la participation financière aux entreprises de 20 à 50 salariés. Une extension au seuil de 10 salariés peut être ultérieurement envisagée, sous réserve d’une étude d’impact.
Les trois articles qui suivent visent à établir un contrat entre l’entreprise et les différentes échelles géographiques où elle exerce son activité, du territoire à la planète.
L’article 5 : « transparence des transactions » vise à éviter les abus de droit en matière de création artificielles de pertes de valeurs. En application des nouvelles règles posées par les ordonnances « travail », lorsqu’une entreprise connaît des difficultés économiques, elle peut engager des licenciements qui seront désormais appréciés sur le seul périmètre national de la branche concernée. Pour pallier les faiblesses d’un contrôle facultatif et a posteriori, cet article prévoit de demander au Gouvernement un rapport sur l’établissement d’un contrôle a priori sur la sincérité des transactions entre les branches et entre les pays au sein d’une même entreprise, qui prendrait la forme d’un rescrit social.
L’article 6 : « transparence fiscale » prend en compte les stratégies internationales des entreprises qui leur permettent de réduire considérablement leur base imposable en usant de méthodes qui, sans être à ce jour illégales, sont, le plus souvent, techniquement factices et moralement inacceptables. Comme l’a confirmé l’enquête dite des « Paradise Papers », ce scandale mine la puissance publique dans ses ressources et son autorité. Prenant acte de la censure du Conseil constitutionnel des dispositions de la loi dite Sapin 2 visant à la transparence des sociétés, il est proposé dans cet article de reprendre la préconisation du rapport Dulin au CESE en ajoutant un reporting fiscal complet aux IRP lesquelles sont tenues à la confidentialité des informations transmises.
En outre, des précisions sont apportées en vue de renforcer la qualité du dialogue social.
L’article 7 : « dialogue territorial » demande un rapport au Gouvernement sur les règles propres à établir un ancrage plus fort de l’entreprise dans son écosystème territorial sur les champs prospectifs de la gestion prévisionnelle des emplois, de l’investissement public pour les infrastructures économiques ainsi que du pacte fiscal et réglementaire. Ces règles seront particulièrement précieuses dans le cas des filiales dont les centres de décisions sont extérieurs au territoire d’implantation. Par ailleurs, ce rapport explorera les solutions opportunes pour faire face aux défaillances ou aux phases de transition stratégiques des entreprises sur le territoire concerné.
Les quatre derniers articles concernent l’enracinement de l’entreprise dans la société.
L’article 8 : « un écart maximum de revenus ». Les inégalités de revenus sont devenues telles qu’elles meurtrissent le sentiment d’appartenance à la communauté de l’entreprise comme à celle de la Nation. Alors qu’une certaine indécence nourrit en retour l’indolence civique, il apparaît a contrario qu’une société plus équitable est aussi une société plus créative. Il est donc demandé au Gouvernement un rapport d’information sur le principe d’un écart maximal décent de rémunération.
L’article 9 : « les formes ouvertes d’entreprise » vise à permettre à d’autres formes d’entreprise d’émerger et de se développer. Il s’agit tout d’abord de renforcer le régime de l’agrément Entreprises solidaires d’utilité sociale au niveau national et local. La perspective ouverte est de favoriser l’hybridation avec l’économie traditionnelle et de permettre, au-delà des statuts, et sans préjuger de la nécessité de leur adaptation, de franchir un nouveau cap de développement.
Il vise aussi une extension des autorisations des temps partiels afin de permettre aux parties prenantes de mieux accomplir leurs projets de vie lorsqu’ils souhaitent s’engager sur le plan civique.
Il propose par ailleurs d’introduire en France les « sociétés à mission », à l’image de ce qui se fait dans des pays comme la Suisse, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Il s’agit de pouvoir mobiliser tous les acteurs de l’entreprise autour d’un objet social incluant un objectif social ou environnemental. Si la souplesse du dispositif s’impose pour en garantir l’attractivité, deux principes s’appliqueront pour s’assurer de la réalité de la mission et éviter un simple effet d’affichage : d’une part, la mission devra être définie à la fois par les actionnaires (qui l’inscriront dans les statuts) et par les salariés (qui la valideront par voie d’accord d’entreprise) et, d’autre part, un comité de suivi de la mission, composé au minimum de 40 % de membres désignés par les salariés (parmi les salariés ou en dehors d’eux), devra disposer des moyens et pouvoirs nécessaires pour rendre compte de la réalisation de la mission auprès des actionnaires et des salariés.
L’article 11 : « la double notation » : Si les seuls indicateurs classiques de performance économique d’une entreprise nous en donnent une vision borgne, ceux de leur responsabilité sociale et environnementale peuvent procurer une vision floue. L’article 11 propose de confier à un établissement public existant une mission tendant à la création d’un label public, fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des entreprises (RSE), permettant à toute citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateur ou d’épargnant, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en la matière. La création d’indicateurs synthétiques étant une tâche complexe dont les résultats doivent pouvoir évoluer avec les pratiques, il conviendra que la loi fixe les grands principes et délègue à l’établissement public choisi, une mission de préfiguration en la matière.